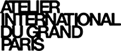Penser les territoires comme des systèmes ouverts et complémentaires
L’organisation de l’action métropolitaine reste – et c’est légitime – fondée sur la structuration des lieux et des liens qui les unissent. C’est le sens de l’institutionnalisation à venir d’un niveau intermédiaire au sein de la MGP – les Conseils de territoire – ou de la réorganisation de la carte intercommunale en grande couronne. Plus largement, la plupart des dispositifs d’action métropolitaine – de la déclinaison de la Territorialisation des Objectifs Logement à la péréquation fiscale – se déploient selon une logique localisée.
Pourtant, la métropolisation révèle avant tout un nouveau rapport entre les flux et les lieux. De là découle le premier défi pour la conception du projet métropolitain, du point de vue de l’architecture de ses territoires : intégrer les flux dans l’organisation des lieux.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il faudrait prendre acte de la disparition des territoires de la métropole, bien au contraire, comme le démontrent les débats actuels en cours qui vont faire l’objet de réflexions et de productions spécifiques de l’AIGP. C’est là le second défi : la métropolisation intègre et disloque. Ainsi assiste-t-on à la fois à l’unification d’un marché du travail métropolitain et à la montée en puissance de marchés localisés. Ce sont sur tous les plans, les niveaux de la métropole et de ses territoires qu’il faut articuler.
Au sein d’une métropole en permanence recomposée par les flux de tous ordres qui la traversent, l’installation d’un niveau intermédiaire d’action collective est indispensable. Tout l’enjeu consiste à prendre acte de la structuration progressive du « local métropolitain ». Mais selon les situations territoriales – à l’Est ou à l’Ouest, en petite ou grande couronnes, à proximité ou non d’une ville nouvelle – et selon les angles d’approche (les relations domicile-travail, l’accès aux services…), ce local métropolitain, c’est-à-dire les réalités du fonctionnement des territoires et des pratiques sociales, ne peut plus s’inscrire dans un cadre homogène et unique. La métropolisation remet en question la représentation d’un « puzzle » des territoires vécus, tout en renouvelant l’inscription locale des pratiques des métropolitains.
Cela signifie que, quels que soient les périmètres institutionnels qui seront définis au sein et autour de la Métropole du Grand Paris, c’est sur la base de ces territoires locaux métropolitains, à géométrie variable selon l’approche retenue, qu’il faudra agir et construire les politiques métropolitaines.
Il s’agit bien de penser les territoires comme des systèmes ouverts et complémentaires.